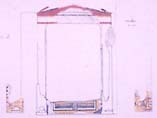|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GABBARI
Tombe B1 - pièce B1.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clichés
CEA droits réservés |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dans
une pièce située au niveau inférieur (B1.7) à
laquelle on accède par un escalier de douze marches, la fouille du
comblement rendue difficile par la présence de la nappe phréatique,
a livré un matériel extrêmement abondant, vases à
parfum, vaisselle de table, lampes, figurines en terre cuite et brûle-parfum,
qu'une première étude a daté de la seconde moitié
du IIIe siècle et du IIe siècle. Un des loculi a livré
cinq hydries de Hadra datées des années 230-220 av.
J.-C. Dans cette pièce, un certain nombre de loculi étaient
encore fermés par des plaques peintes avec un décor de
porte, ou portant une inscription funéraire, ou enfin sans décor,
ni inscription. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
A
côté des inhumations, les Grecs pratiquaient l'incinération
et de petites niches étaient creusées dans les parois des
tombes pour la mise en place des urnes cinéraires. Ces vases connus
sous le nom d'hydries de Hadra pour les pièces peintes, ont été
utilisés comme urnes cinéraires entre 250 et 180 av. J.-C.
dans les nécropoles alexandrines. Ce sont majoritairement des productions
crétoises, mais un atelier alexandrin, reconnaissable à l'argile
utilisée et à certaines caractéristiques du décor,
a fonctionné entre 240 et 210 av. J.-C. Ces hydries portent parfois
une inscription avec le nom du défunt et étaient bouchées
au plâtre avec, dans certains cas, le sceau de la personne chargée
de procéder à l'ensevelissement. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hydries de Hadra crétoises
IIIe siècle avant J.-C.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plaques
peintes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le
décor de fermeture des loculi figurait le plus souvent une porte.
Dans l'agencement le plus simple, la porte est représentée
avec son chambranle, éventuellement surmonté d'une moulure
de couronnement décorée. Un agencement un peu plus complexe
est constitué par la porte surmontée d'un fronton posé
sur le linteau. Des guirlandes sont figurées, suspendues aux acrotères
du fronton. Ces guirlandes peintes reproduisent les véritables guirlandes
qu'on avait coutume d'offrir en l'honneur des morts. Dans l'agencement le
plus complet, la porte et son chambranle sont encadrés d'un ordre
architectural formé de pilastres supportant l'entablement et le fronton
(représentations ci-dessous). |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
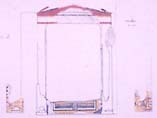 |
|
|
|
|
|
|
|
Le
décor de cette plaque montre une scène d'adieu de type classique
figurée sur un panneau devant la porte: on y voit la défunte
assise serrant la main de l'homme debout qui la salue (passez la souris
dessus pour voir les détails). |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |